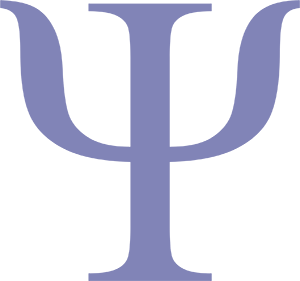Analyse psychanalytique de la série Adolescence sur Netflix : passage à l’acte et acting out
La mini-série Adolescence sur Netflix explore un passage à l’acte sidérant car commis par un adolescent envers une camarade de classe.
Mais au-delà du choc et de l’effroi que provoque cet acte, que pourrions-nous y comprendre ?
Plutôt qu’un éclairage psychologique profond, la série semble figer le spectateur dans l’angoisse — un ressort narratif certes propice à un succès médiatique.
Une série Netflix centrée sur l’effroi plus que sur une tentative d’entendement
Dans Adolescence, aucun épisode n’est consacré à entendre ce que ce jeune « héros » a à dire.
En effet, on nous le mon(s)tre, nous le voyons, mais nous ne l’entendons pas véritablement :
-
Épisode 1 : son avocat lui demande de garder le silence.
-
Épisode 3 : la psychologue alterne cadeaux, blagues et faux-semblants au milieu d’un flot de questions.
Le jeune homme le lui dit d’ailleurs que, dans un premier temps, elle posait des questions intéressantes, car portant sur l’acte lui-même, les notions de bien et de mal.
Un regard psychanalytique sur le passage adolescent
En mobilisant la clinique de Freud et Lacan, nous pourrions tenter de poser des hypothèses interprétatives. En tenant compte de l’inscription de cet acte dans un retour puissant du pulsionnel caractéristique du passage adolescent.
Acting out et passage à l’acte : deux notions distinctes
-
Acting out : une conduite où le moi s’offre en spectacle, dans une adresse à l’autre qui demande à être interprétée. Cela pourrait correspondre au comportement du garçon lors de la séance avec la psychologue, puisqu’il lui ‘montre’ la violence qui le traverse.
-
Passage à l’acte : une conduite plus impulsive, irrépressible, et déclenchée par un moment d’angoisse intense, insupportable.
Hypothèses cliniques autour du passage à l’acte de l’adolescent
Nous pourrions envisager plusieurs pistes :
-
Une persécution réelle prolongée, produisant chez lui une pulsion agressive devenue incontrôlable.
-
Une persécution imaginaire, élaborée par un garçon en proie à la paranoia (trouble psychotique).
-
Un désir interdit de jouir de l’autre, dont l’impossible satisfaction serait vécue comme insupportable, au point d’imaginer que supprimer l’autre supprimerait la souffrance.
-
Un jeune aux traits pervers, connaissant l’interdit de tuer mais le contournant avec une justification interne légitime à ses yeux.
La vérité subjective de l’acte
La vérité de ce passage à l’acte appartient au jeune lui-même. Il s’agit de sa vérité subjective.
Seul un travail dans la durée avec un patient qui désirerait s’y engager, une écoute sans jugement et un espace de parole libre pourraient lui permettre d’élaborer ce qui l’a conduit à franchir la loi symbolique : « Tu ne tueras point ».